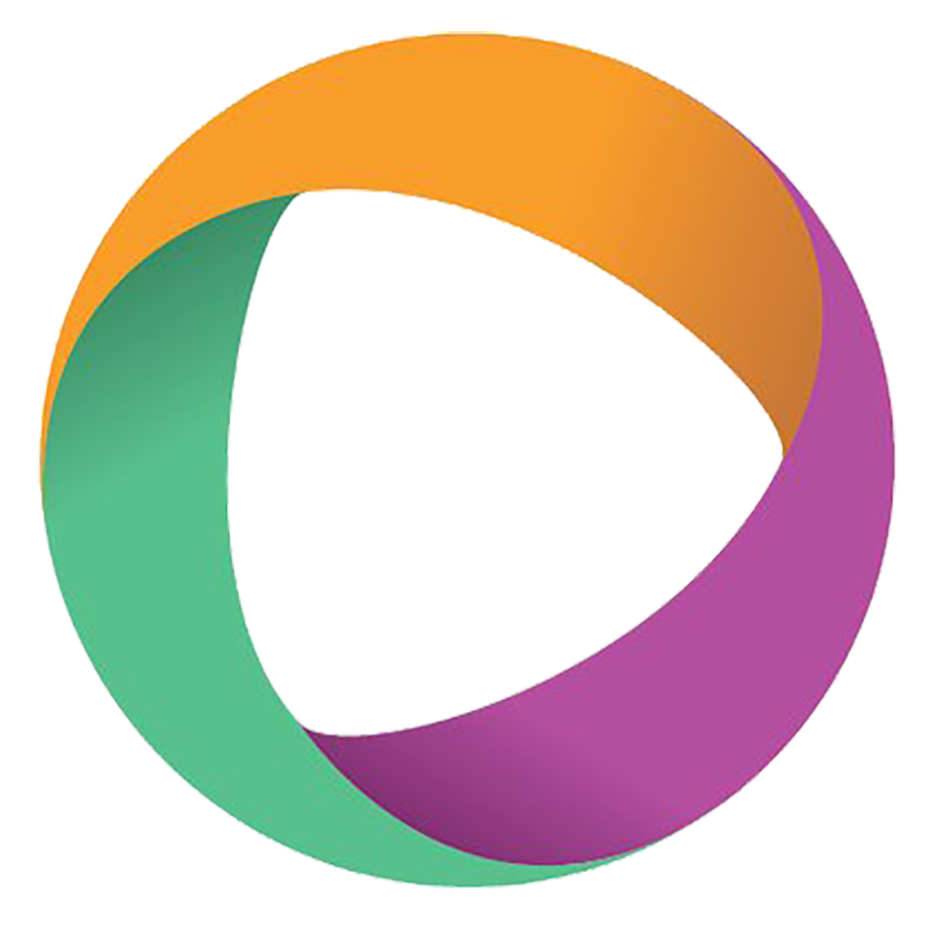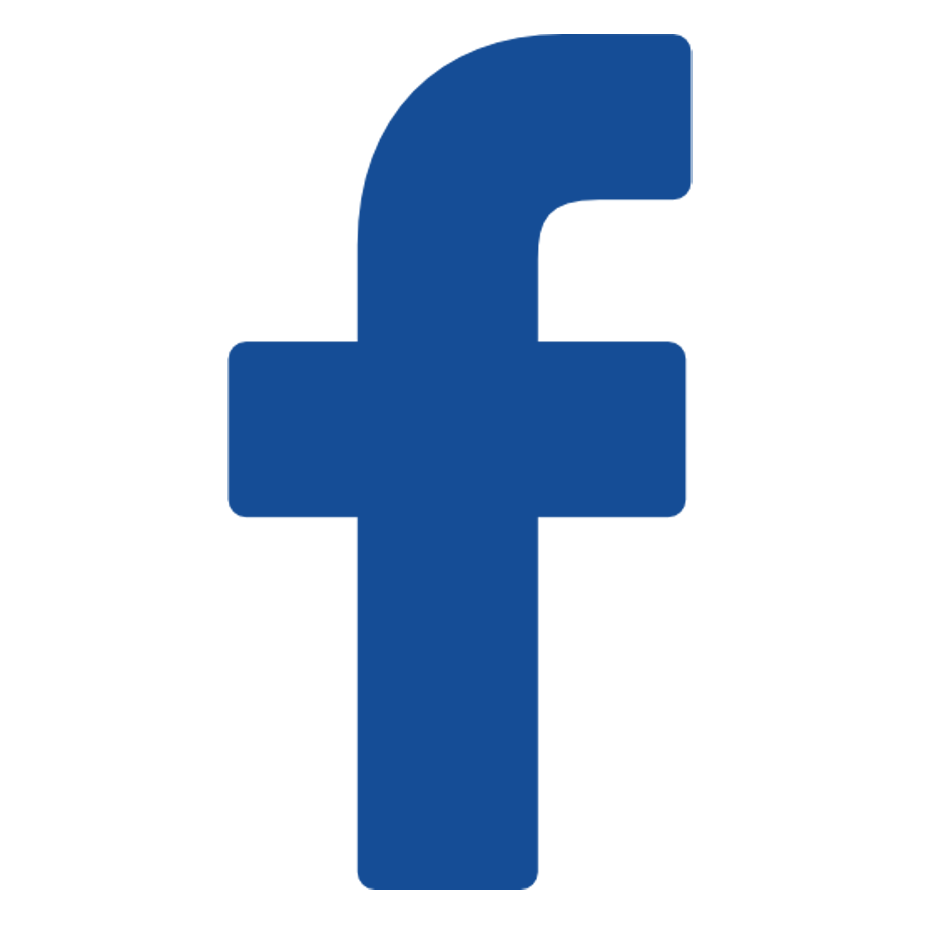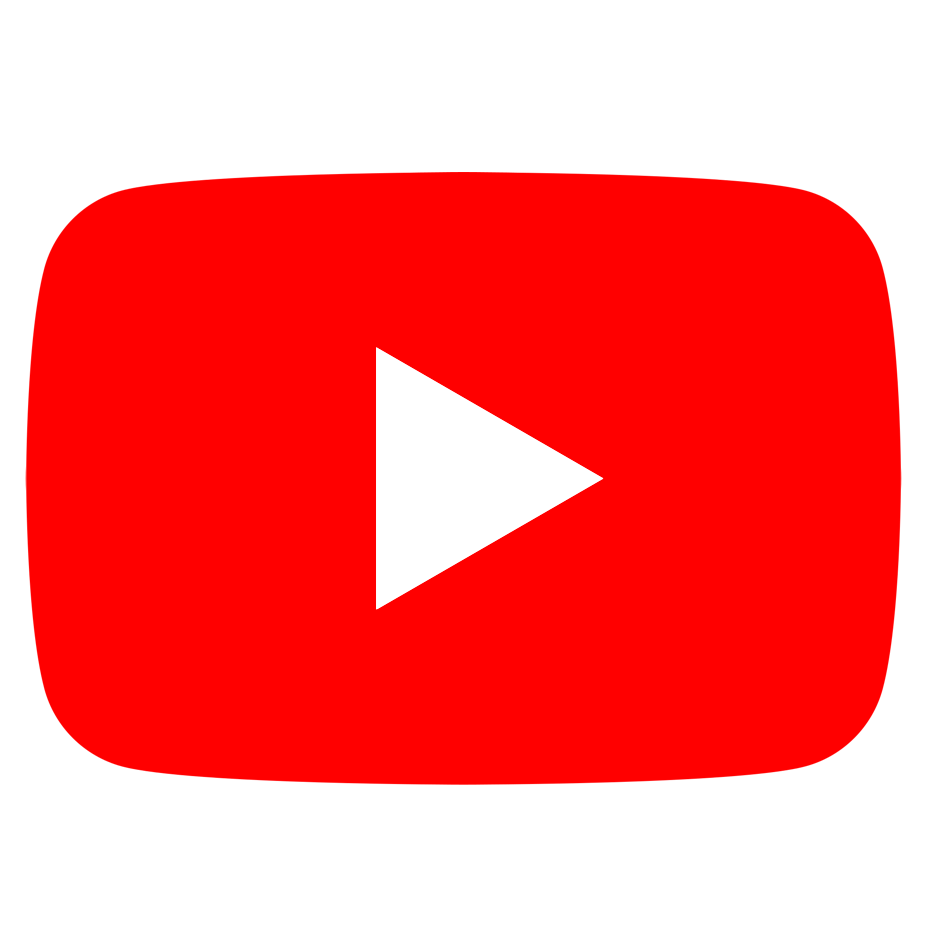Un résumé des conférences de l'édition 2024
Vous pouvez retrouver ici un résumé de chacune des conférences (rédaction P. Biscay)
Conférence Jean-Luc Atteia
- Jean-Luc Atteia, astrophysicien à l’IRAP, a parlé de SVOM, lancé depuis la Chine en Juin 2024 pour surveiller les explosions cosmiques. C’est un nouvel outil d’étude des trous noirs, de la mort des étoiles et des débuts de l’univers. Il mesure les flashs (« sursauts ») de rayons gamma générés par ces explosions qui libèrent d’énormes quantités d’énergie et sont très rares et très lumineuses, visibles à de très grandes distances. Ces phénomènes sont liés aux objets compacts (trous noirs, étoiles à neutrons). Ces sursauts, découverts en 1967, sont suivis de l’apparition d’une « nouvelle étoile » qui s’éteint rapidement. Ce sont ces émissions transitoires, aléatoires et rares qu’on cherche à mesurer. Mais SVOM ne suffit pas et on a en fait un « système » SVOM. En effet, on veut détecter les explosions depuis l’espace, pointer rapidement le satellite vers l’astre qui a explosé, recevoir l’information au sol en moins d’une minute, pointer les télescopes robotiques terrestres de SVOM vers l’explosion, analyser automatiquement les images obtenues pour savoir s’il faut mobiliser les télescopes « mastodontes (Chili, Hawaii ou Canaries). L’outil ECLAIRs de SVOM détecte la position dans l’espace du sursaut selon le principe d’imagerie à masque codé. Le masque codé, intercalé entre la source et le détecteur, est opaque à ce rayonnement mais percé de trous qui laissent passer celui-ci. Les photons qui viennent frapper le détecteur projettent une ombre portée de ce masque, tel un cadran solaire. Le décalage horizontal de cette ombre portée sur le détecteur permet de calculer la position de la source dans le ciel et d’orienter SVOM vers la source. A la date de la conférence, tous les systèmes du satellite sont opérationnels. Il n’y a plus d’obstacles de principe à la réalisation de campagne d’observation durant les prochaines années !
Didier Massonnet
- Didier Massonnet, ingénieur au CNES, nous présenté le projet PHARAO de mesure ultra précise du temps. Premier besoin : améliorer la précision des systèmes GPS, constitués de satellites qui maillent la surface terrestre, équipés d’horloges atomiques et envoient leur position et leur temps. A partir des mesures de 4 satellites, et via les équations de la relativité générales, on déduit les 3 coordonnées de position et l’heure de n’importe quel récepteur GPS terrestre. Toute incertitude sur la mesure du temps dégrade la précision de ces coordonnées. Deuxième besoin : jusqu’à ce jour, la théorie de la relativité générale est restée valide (à 10-5 près, précision résultante des précisions de mesures d’espace et de temps (10-14). Le but scientifique de PHARAO est de vérifier si la théorie de la relativité résiste à une mesure ultra précise de la seconde (10-16) qui ferait chuter l’incertitude à 10-6. Les clés d’une horloge sont la stabilité, ce qui nécessite un temps suffisant de mesure, et l’exactitude qui résulte des diverses perturbations de l’environnement naturel (variation de la rotation terrestre, du champ électromagnétique ambiant, ...). L’horloge embarquée est de type césium en fontaine atomique (voir par exemple https://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge_atomique). PHARAO mesurera la différence de ralentissement du temps entre le sol et l’altitude de la Station Spatiale Internationale (ISS), soit 0.4 10-10 s. La précision de la mesure de la seconde étant de 10-16, la précision relative du ralentissement du temps sera bien de 10-6. La mise en orbite de PHARAO est prévue début 2025.
Conférence Salomé Fuenmayor et Sylvie Vauclair
- Salomé Fuenmayor, infographiste, et Sylvie Vauclair, astrophysicienne, ont fait le point sur les observations déjà engrangées par le télescope spatial James Webb et comment sont élaborées les images astronomiques permettant au grand public d’appréhender un peu mieux les avancées scientifiques qui en découlent. Sylvie a rappelé les multiples objectifs des observations du ciel en infrarouge : observer les premières galaxies de l’Univers, étudier les structures profondes des galaxies, analyser en détail les nébuleuses, lieux de naissance des systèmes planétaires et enfin observer les systèmes planétaires extrasolaires et les planètes et objets célestes du système solaire. La moisson est d’ores et déjà extraordinairement riche et montre le besoin de raffiner encore les modèles cosmologiques. Elle a illustré tout cela par la toute première image diffusée auprès du public, image reconstituée par Salomé. Elle a aussi insisté sur certaines publications grand public qui, s’appuyant sur des extrapolations « hasardeuses » non-scientifiques, traduisant surtout une recherche de « sensationnel » pour faire de l’audience. Salomé a ensuite expliqué comment elle a pu, en quelques heures (5 !) élaborer cette première image couleur qui a fait le tour du monde, du site de la NASA à la couverture du magazine Science. Elle est partie des toutes premières cartes du ciel acquises dans différentes longueurs d’ondes infrarouges et post-traitées par les chercheurs, cartes initialement en niveau de gris. Elle les a dépixélisées par lissage puis superposées. Elle les a ensuite colorisées avec un choix de palette de couleurs permettant de rendre visible le maximum possible des structures contenues dans les cartes d’origine. Enfin, les artefacts résiduels ont été éliminés, par exemple des petites taches noires au centre des structures observées les plus brillantes (étoiles, …). Le but de ces images est de communiquer avec le public, de lui faire ressentir l’intérêt de ces recherches et les avancées obtenues. Les scientifiques, eux, vont poursuivre leurs travaux sur la base des images en niveau de gris, car c’est là que se trouve l’intégralité de l’information.
Conférence Colin Bouchard
- Colin Bouchard, docteur en écologie piscicole, a présenté la situation du saumon atlantique sauvage en France, et plus particulièrement dans les rivières pyrénéennes. Il a décrit le cycle de vie du saumon atlantique, de la naissance dans sa rivière natale à l’océan puis son retour vers cette rivière. Les zones de peuplement s’étalent en Europe du nord de la Norvège à la Galice. La population de saumons se réduit fortement depuis quelques années. Sur 2359 rivières répertoriés en 2016 en Europe, 43% sont aujourd’hui à risque d’extinction et dans 7% la population s’est éteinte. La France n’échappe pas à ce constat (nombre de rivières et population). Les causes de ce déclin démographique sont multiples, déclin qui commence dès le séjour en mer : taux de survie des œufs divisé par 2 par rapport aux années 1980, déclin généralisé des prises de saumons adultes et pré-adultes, diminution des taux de retour. Les raisons : diminution de la ressource en zooplancton et en poissons proies du saumon, élévation de la température océanique qui accroit l’âge de maturité et diminue la taille adulte des saumons, stress crée par les élevages de saumon (multiplication des poux de mers, transmission d’épizooties). Ce déclin se poursuit en rivière. Sur le bassin de l’Adour, après une lente remontée de la population à partir des années 2000, la population se réduit fortement depuis 2020. Le saumon tente de revenir à sa rivière natale, avec un taux de succès de 80% environ. Il en résulte une tendance à l’adaptation locale qui ne traduit par une certaine différentiation génétique. Néanmoins, les 20% qui reviennent ailleurs que dans leur rivière natale font qu’aucune rivière n’est totalement isolée. Un brassage génétique régional subsiste et tend à créer une métapopulation réagissant de façon synchronisée et possiblement plus adaptable aux changements climatiques en cours. Le saumon ne régule pas sa température corporelle. L’élévation constatées des températures estivales moyennes de l’eau des rivières affecte sa croissance, ralentit son activité et in-fine détériore son taux de survie estivale. Le saumon recherche les zones froides des rivières (refuges thermiques), mais la diminution en cours des débits d’étiage et les aménagements humains tendent à les faire disparaître, ce qui contribue un peu plus à la mortalité estivale. De plus, certains de ces aménagements humains entravent la migration des saumons, ce qui diminue les taux de reproduction. La pression de la pêche dans l’estuaire de l’Adour n’est donc qu’une des causes du déclin des populations, mais elle y contribue de façon évidente. Le nombre total de prises (professionnelles ou récréatives) est en effet supérieur aux comptages mis en place. Il faut donc impérativement mettre en place une gestion adaptative destinée à la fois à soutenir les populations (alevinage), à améliorer les taux de survie estivale (créer des refuges thermiques) et réguler davantage les nombres de prises.
Conférence Mehrez Zribi
- Mehrez Zribi, directeur de l’OMP. L’eau douce représente 2.5% de l’eau présente à la surface de la terre, y compris les nappes souterraines accessibles. Les glaciers en contiennent 1.7%, les nappes souterraines 0.8% et les eaux de surface 0.03%. L’accès à l’eau douce est indispensable à notre survie. Or, le changement climatique en cours entraîne une augmentation de la fréquence, de l’intensité et la durée des évènements caniculaires, de l’intensité des fortes précipitations de la fréquence et l’intensité des sécheresses. Les températures océaniques augmentent également, ce qui a un impact sur leur biodiversité et la ressource halieutique. Un suivi du cycle de l’eau est donc nécessaire à toutes les échelles, du local au global. Dans ce contexte, la télédétection spatiale dans différentes longueurs d’onde joue un rôle essentiel pour l’observation des surfaces terrestres. Elle permet de quantifier la dynamique temporelle de l’occupation du sol (neige, feuillage) via le visible, l’évapotranspiration via les températures de surface, le contenu en eau des nuages via les températures en sommet des nuages, l’humidité des sols, le contenu en eau liquide des manteaux neigeux et les hauteurs d’eau libre via les microondes. Différents exemples ont été présentés et montrent que les progrès récents offrent une résolution à l’échelle de la parcelle agricole, par exemple le satellite SWOT pour l’altimétrie. Le satellite GRACE relève les variations locales de la gravité terrestre. Ces « anomalies » permettent de remonter à la masse des aquifères et suivre leur variation temporelle. L’ensemble de ces outils fournit donc les informations nécessaires à une meilleure gestion, locale ou globalisée, de la ressource en eau. Ce point est crucial dans le contexte du réchauffement climatique dont Mehrez a rappelé que « Le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant » (atténuer) mais qu’il va falloir aussi s’adapter. Les pistes pour s’adapter : Evoluer dans la gestion des ressources en eau agricole, adapter les cultures agricoles, développer de nouvelles techniques et infrastructures si besoin, consolider des outils de décision, consolider l’accompagnements face aux évènements extrêmes, garantir l’équilibre disponibilité de l’eau / environnement, renforcer l’éducation à l’économie de l’eau
Film, La Rivière
- Projection du film « La rivière » et débat avec Patrick Nuques, intervenant du film, et Etienne Farand, Docteur en dynamique des populations et spécialiste de la biodiversité dans le Parc National des Pyrénées. L’envoûtant et très beau film documentaire de Dominique Marchais fait prendre conscience de l’évolution récente du système hydrographique des Pyrénées Atlantiques, système qui, de prime abord, semble pourtant encore préservé. Les témoignages de personnes ayant connu ces rivières, le gave d’Oloron en particulier, il y a plusieurs décennies, nous font sentir et prendre conscience qu’il n’en est rien. Il y a bien une dégradation de l’état général des rivières et perte systémique de biodiversité, animale et végétale. Les témoins la relient aux aménagements survenus, aux pratiques agricoles, au déboisement des berges, au changement climatique, à la surexploitation des ressources. C’est certes un film militant, mais le constat et les causes recoupent largement les analyses des scientifiques, tels Colin Bouchard. Le débat a permis qui a suivi a permis de compléter ces témoignages du film et d’approfondir l’analyse des causes.
Conférence Mélanie Rochoux
- Mélanie Rochoux, CERFACS Toulouse, pose la question : comment anticiper les feux de forêts de demain ? Nous assistons en effet à l’émergence de feux hors-norme, les mégafeux, à travers de multiples écosystèmes (savane, bush, forêts boréales, méditerranéennes, tourbières) du fait de l’intensification des sécheresses. Ces évènements deviennent, sous l'effet du changement climatique, plus probables, plus intenses et ont des impacts de plus en plus forts, y compris jusqu’à de grandes distances : destruction des habitats, érosion des sols, dégradation de la qualité de l’air par pollution gazeuse et aux particules fines PM2.5, émission massive de gaz à effet de serre CH4 et CO2, … Ils sont marqueur et facteur aggravant du changement climatique. Les phénomènes mis en jeu lors des mégafeux : propagation en surface (litière, strate arbustive) plus rapide sous l’effet du vent et en pente, dynamique des flammes (réactions chimiques, écoulement local, ...), propagation des flammes jusqu’à la canopée qui les agrandit et produit un entraînement d’air plus intense, projection de brandons à grande distance qui crée de nouveaux foyers, modification du vent de surface, création de cumulonimbus avec forte perturbation des vents de surface et production d’éclairs pouvant allumer de nouveaux feux à grande distance, injection de particules dans la stratosphère d’une ampleur similaire à des éruptions volcaniques modérées. Un mégafeu arrive à modifier les conditions météorologiques locales, voire régionales qui en retour aggravent sa criticité. En France, un feu ayant parcouru plus de 5000 ha est classé « mégafeu », ce qui est le cas des incendies de 2022 dans le Sud Gironde. L’évolution prévisible du climat fait que la zone à risque de mégafeux, cantonnée avant 2015 au pourtour méditerranéen, va s’étendre à une grande partie du territoire. Le rapport des Missions Interministérielles « Feux de forêt » (2023) définit 2 objectifs : faire face à court terme et s’adapter au changement d’ère, i.e. apprendre à vivre avec le feu à moyen et long terme. La problématique identifiée est en effet que : multiples interfaces forêt-habitat, comment discriminer les situations à risque en cas de conditions météorologiques extrêmes, comment anticiper où des grands feux peuvent se développer, comment mieux représenter le lien entre végétation, climat et feux pour anticiper les nouvelles zones géographiques qui pourraient être touchées par les feux dans le futur. Par ailleurs, comment évaluer le risque de sautes de feu à grande distance en situation réelle, risque pouvant entraîner des morts dans des zones supposées « sûres » (cas du mégafeu portugais 2019 ayant causé près de 100 morts). Un moyen de répondre à ces objectifs est de développer une capacité à simuler le comportement des feux de forêts aux échelles géographiques pertinentes. C’est ce qui est en cours, en particulier au CERFACS. La feuille de route est : comprendre les processus qui pilotent le développement de grands feux et les modéliser, par exemple la propagation du front de flamme, implémenter ces modélisations dans un modèle numérique capable par ailleurs de simuler la modification du champ météorologique par le mégafeu lui-même, le calibrer sur des feux expérimentaux contrôlés, l’évaluer sur des cas réels. Les paramètres principaux de calibration / validation sont la progression du front de flamme et l’extension finale de la zone parcourue. Mélanie a présenté quelques résultats : un degré de calibration satisfaisant a permis de passer à la confrontation sur des cas réels suffisamment documentés. Le modèle représente assez correctement l’évolution du front de flamme sur le cas portugais. Pour aller plus loin dans la compréhension et la validation, la campagne Européenne EUBURN prévue à partir de 2025 fournira des observations de feux et des panaches à très haute résolution spatio-temporelle. Utiliser ce modèle numérique pour répondre aux questions soulevées dans le rapport ministériel va nécessiter de disposer d’une cartographie satellitaire couplée végétation / habitat aux échelles de la France et de l’Europe, à haute résolution, de l’ordre du km. L’utiliser en temps réel pour l’aide à la décision et la gestion des mégafeux va aussi nécessiter des modélisations spécifiques pour réduire drastiquement les temps de calcul et produire dans des délais adéquats (typiquement de l’ordre de l’heure) des cartes probabilistes d’évolution du front de flamme. Les résultats sont encourageants, il reste un long chemin à parcourir, mais le jeu en vaut la chandelle (si on peut dire !)
Conférence Louis Viel
- Louis Viel, plasticien et docteur en art plastique, a montré comment l’art peut permettre à l’homme de penser le rapport à la nature, à l’ère de l’anthropocène. Faire de l’art, c’est créer un système symbolique, sachant que « L’art permet à l’homme de s’interroger sur lui-même et sur la société dans laquelle il vit», a dit Laurent Terzieff. S’approprier une œuvre d’art contemporain est une expérience que certains publics hésitent à aborder. Dans sa démarche artistique, Louis Viel propose deux expositions photos, un livre et une conférence, ensemble qui peut, par ces diverses formes, participer à une aide à l’acquisition et à un regard sur les œuvres d’art. L’exposition comprend un site extérieur avec des photographies de glaciers et de cascades, qui témoignent d’une nature laquelle, à terme, ne sera plus là en raison du changement de climat. Ces photographies, prises dans diverses contrées de la planète, se veulent porter des évènements terrestres comme la fonte des glaciers et la répercussion de ces disparitions sur la diminution de l’eau disponible pour tout vivant. Deux lieux à l’intérieur de cette salle, remarquable par sa charpente, accueillent une série d’images de volcans et de glaciers pour nous dire que le volcan est la manifestation de la vie originelle de la planète, une vie naturelle. Par contre, si les glaciers sont en cours de disparition, c’est bien l’activité humaine qui en a la responsabilité. Quant à cette série de plantules résilientes, se développant dans des lieux improbables, elles portent le message de Sylvie Vauclair dans la préface du livre titré « Du Cri Retenu de la Terre» : « si l’humanité disparaissait, il y a fort à parier que la terre reprendrait ses droits petit à petit en pansant elle-même ses blessures ».